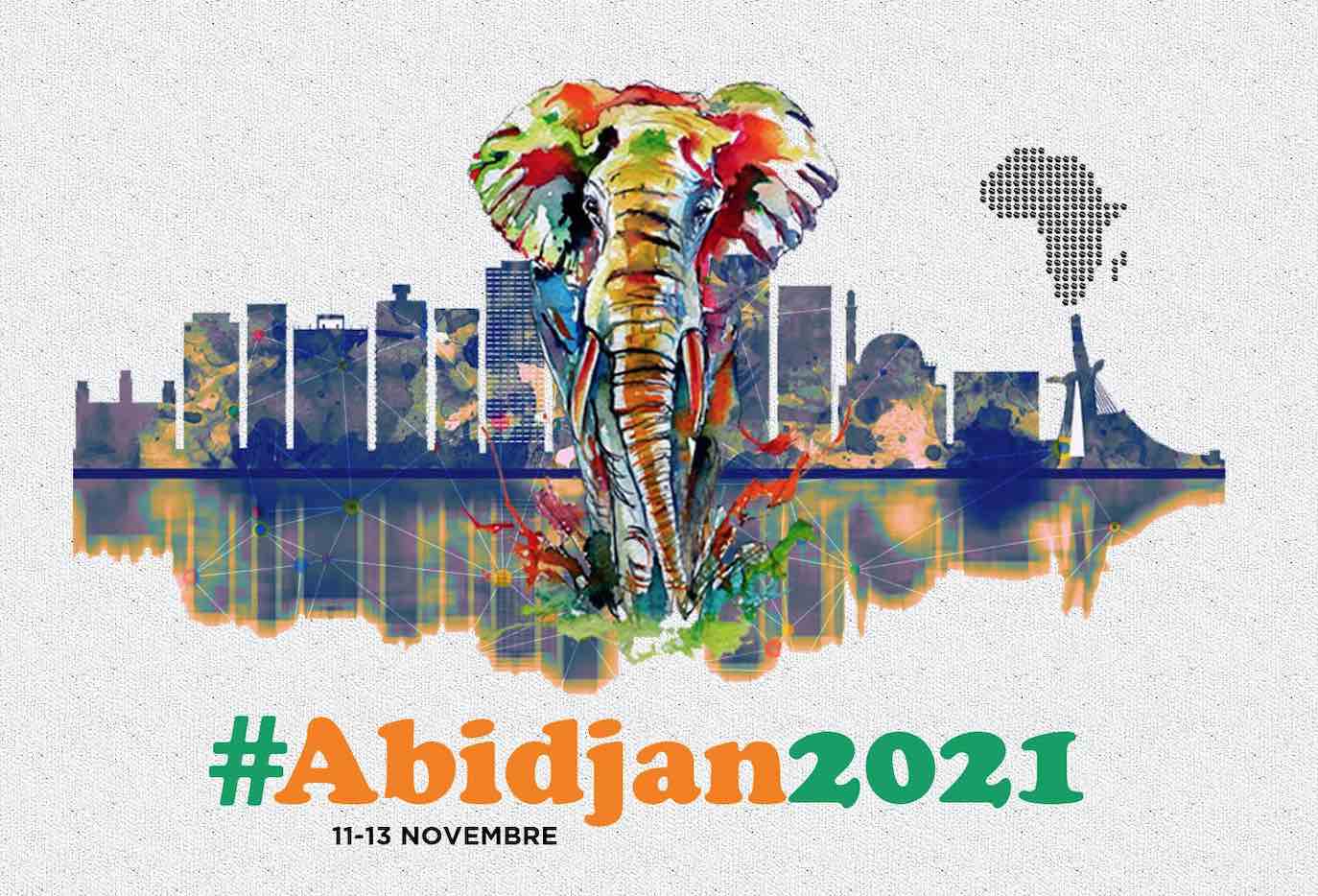(Agence Ecofin) - En décembre 2021, on célèbrera le 70e anniversaire de la mise en service, dans le désert de l’Idaho aux États-Unis, du premier réacteur nucléaire au monde destiné à produire de l’électricité. Aujourd’hui, le nucléaire civil s’est étendu à une trentaine de pays à travers le globe qui y voient, entre autres, un moyen d’obtenir de l’énergie sans émettre de CO2, l’un des gaz à effet de serres qui menacent notre planète. Si la promotion des énergies renouvelables est aujourd’hui la norme à cause justement de l’absence de pollution liée au dioxyde de carbone, le recours au nucléaire peut donc se défendre pour la même raison. Une alternative qui pourrait relancer la production africaine d’uranium.
Regain d’intérêt pour l’uranium
Le prix de l’uranium, qui suit une tendance haussière depuis plus d’un an, a atteint de nouveaux sommets la semaine dernière. Le minerai a grimpé à son plus haut niveau depuis 2014, s’échangeant jusqu’à 44 $ la livre au comptant.
Quelqu’un a une explication de la soudaine flambée des cours de l’uranium ? pic.twitter.com/3N2hYcFFs9
— Ze XXC Benard (@vbenard) September 14, 2021
Ce bond s’explique par les achats massifs d’une fiducie, Sprott Asset Management LP. La société d’investissement s’est approvisionnée massivement en uranium sur le marché physique, achetant par exemple jusqu’à 3 millions de livres entre le 2 et le 7 septembre.
La société d’investissement s’est approvisionnée massivement en uranium sur le marché physique, achetant par exemple jusqu’à 3 millions de livres entre le 2 et le 7 septembre.
À cette date, Sprott Asset Management détenait alors 24 millions de livres, soit plus du quart du volume au comptant échangé l’année dernière (92,2 millions de livres, selon la société Yellow Cake Plc). Si cette hausse des prix n’a qu’un impact limité sur les exploitants de centrales nucléaires, qui s’approvisionnent plutôt sur le marché à terme, il faut noter qu’elle traduit un regain d’intérêt pour le nucléaire. Le redressement du prix de l’uranium en cours depuis plus d’un an (la livre s’est négociée à 34 $ en mai 2020 contre moins de 20 $ en novembre 2016) s’explique par des prévisions largement partagées sur une augmentation de la demande mondiale à moyen et long terme, à cause du développement de nouveaux projets de centrales nucléaires.
Dans la course à la réduction de l’utilisation des énergies fossiles, le nucléaire revient sur le devant de la scène, car elle est considérée comme une énergie propre. Les seules émissions de CO2 qu’on peut lier à la production d’électricité par le biais du nucléaire, concernent essentiellement l’extraction de l’uranium et son transport jusqu’à la centrale. De plus, le nucléaire est une forme d’énergie beaucoup plus concentrée que les énergies fossiles. Selon le Commissariat français à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), 1 kg d’uranium naturel fournit ainsi plus de 10 000 fois la quantité de chaleur produite par un 1 kg de charbon. Cela pousse notamment Jonathan Hinze, président de la société de conseil en combustible nucléaire UxC, LLC, à affirmer qu’il « est presque impossible de voir comment la décarbonisation peut être réalisée sans inclure l’énergie nucléaire ».
Cela pousse notamment Jonathan Hinze, président de la société de conseil en combustible nucléaire UxC, LLC, à affirmer qu’il « est presque impossible de voir comment la décarbonisation peut être réalisée sans inclure l’énergie nucléaire ».
Ce n’est donc pas un hasard si l’Asie, région très critiquée à cause de son usage intensif des énergies fossiles (Chine et Inde en tête), est aussi en tête dans la course pour se doter de capacités de production d’énergie nucléaire. La région abrite ainsi 60% des nouveaux réacteurs en construction dans le monde, avec 16 pour l’empire du Milieu et 6 pour l’Inde sur les 57 en construction à la mi-2021, selon les données de World Nuclear.
Au passage, les prix de l’uranium viennent juste de passer $50/lb, x2 en 18 mois et au plus haut depuis 9ans. La production US va rependre rapidement au rythme où vont les choses! (Probablement un record historique au delà des $150 dans les mois à venir)
— idnca (@idnca) September 16, 2021
Au total, l’organisation indique que la capacité de production nucléaire dans le monde devrait augmenter de 2,6% par an pour atteindre 439 GWe en 2030 et 615 GWe d’ici 2040, contre 394 GWe actuellement. La demande mondiale d’uranium suivra évidemment la même tendance, passant de 62 500 tonnes cette année à environ 80 000 tonnes en 2030 puis 112 300 tonnes d’ici 2040.
Un lourd passé difficile à oublier
Malgré ces avantages, le nucléaire a connu quelques déboires au cours de l’histoire. Le développement du nucléaire civil est en effet intimement lié à deux catastrophes majeures qui sont autant d’exemples cités par les partisans d’un abandon de cette source d’énergie. Pourtant, les débuts du secteur sont idylliques, avec la construction de centrales nucléaires dans toutes les grandes puissances, de la Russie au Royaume-Uni en passant par l’Allemagne. Il faut dire que les deux chocs pétroliers des années 1970 contribuent aussi à convaincre les gouvernants de la nécessité de diversifier les sources d’électricité. Cette période de grâce prendra néanmoins fin avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) en 1986. Des défauts de conception et une série d’erreurs humaines conduisent à l’explosion de l’un des réacteurs de la centrale et les éléments radioactifs qui s’en échappent ont des conséquences sanitaires et environnementales importantes, provoquant dans les années qui suivent l’instauration de plusieurs moratoires sur la construction de centrales. Mais si les besoins mondiaux en énergie augmentent et voient le nucléaire revenir en grâce au cours des années 2000, l’accident nucléaire de Fukushima provoque à nouveau un abandon, définitif désormais, dans plusieurs pays.
Si l’impact environnemental et humain de cette catastrophe n’est pas aussi important que celle de Tchernobyl, elle suscite en effet une remise en cause profonde de la sécurité, tant vantée, des installations nucléaires. Le fait que le Japon soit alors considéré comme un pays bien plus développé que l’URSS des années 80, favorise aussi les comparaisons avec des pays comme la France et l’Allemagne. Cette dernière décidera dès 2011, à une majorité écrasante des députés réunis au Bundestag, de fermer les 17 centrales nucléaires du pays au plus tard le 31 décembre 2022. L’objectif est en passe d’être atteint puisque d’ici la fin de l’année, trois des six dernières centrales encore en activité cesseront de fonctionner. Cela posera un autre défi pour ce qui concerne l’approvisionnement électrique, car le nucléaire représente encore 11% de l’électricité produite dans le pays.
Alors que l’accident nucléaire de 1986 n’avait eu qu’un impact limité sur l’Afrique, celle de 2011 provoque l’arrêt de plusieurs mines d’uranium sur le continent quelques années plus tard.
Alors que l’accident nucléaire de 1986 n’avait eu qu’un impact limité sur l’Afrique, celle de 2011 provoque l’arrêt de plusieurs mines d’uranium sur le continent quelques années plus tard.
Le pays le plus touché est alors la Namibie, dont les déboires du secteur minier contribuent à mettre en récession. Les projets en cours de développement dans le pays, mais aussi au Malawi ou au Niger, connaissent un ralentissement important du fait de la baisse de la demande mondiale d’uranium qui a entrainé un désintérêt des investisseurs.
Des perspectives intéressantes pour le continent
Comme l’indique l’édition 2021 du Nuclear Fuel Report, « un certain nombre de projets à des stades très avancés de développement [attendaient] une amélioration de la situation du marché de l'offre et de la demande pour commencer à produire de l'uranium ». Une affirmation qui se vérifie déjà depuis quelques mois en Afrique.
Les prix de l'uranium s'envolent, dopant les cours des actions des sociétés qui opèrent dans ce domaine. D’ailleurs, la hausse commence à attirer les regards au-delà de la sphère des professionnels. https://t.co/7WUI0MhBAO
— Cyrille RESTIER (@CyrilleRestier) September 16, 2021
Au Niger, par exemple, leader africain de l’uranium, la compagnie minière Global Atomic compte lancer la construction de la mine Dasa début 2022, selon des propos tenus par son PDG Stephen Roman en mars dernier. L’évaluation économique préliminaire publiée en avril 2020 estime que, dans une première phase d’exploitation de 12 ans, le projet peut livrer annuellement 4,4 millions de livres d’uranium à un coût global de 18,39 $ la livre. Alors que la production nationale du Niger est passée d’un pic d’environ 5000 tonnes en 2012, à moins de 3000 t fin 2020, la mine Dasa pourrait permettre au pays d’augmenter sa production et possiblement ses parts de marché sur l’échiquier mondial.
Au Niger, par exemple, leader africain de l’uranium, la compagnie minière Global Atomic compte lancer la construction de la mine Dasa début 2022, selon des propos tenus par son PDG Stephen Roman en mars dernier.
Au Sud du continent cette fois, c’est la Namibie et le Malawi qui devraient être les principaux bénéficiaires du regain d’intérêt pour l’uranium. Paladin Energy relance actuellement son projet Langer Heinrich placé en régime de maintenance et entretien en 2018. Toujours en Namibie, Bannerman Energy a publié en août une étude de préfaisabilité pour son projet d’uranium Etango, une étape qui la rapproche davantage d’une décision d’investissement et du lancement des travaux de construction d’une exploitation minière.
Au Malawi, les ambitions nationales reposent sur Lotus Resources et son projet Kayelekera. Le gouvernement a approuvé ce mois le renouvellement du permis minier de la société, ce qui donne le droit à Lotus d’exploiter les gisements jusqu’en 2037. Selon une étude exploratoire publiée en octobre dernier, elle n’aura besoin que de 50 millions $ pour lancer la production, car il s’agit d’une mine existante, où la production a été suspendue en 2014.
Le thorium est un élément faiblement radioactif facile d’accès. Il représente une alternative intéressante à l’uranium https://t.co/K44YDaDvHt
— Heidi.news (@heidi_news) September 15, 2021
Il ne faut pas oublier l’Afrique du Sud, seul pays du continent à posséder une centrale nucléaire. Avec ses 433 364 tonnes de réserves prouvées en 2010, soit 7% des réserves mondiales connues à l’époque, le pays a aussi un rôle à jouer. Tirer au maximum profit du retour de la demande devra être le mot d’ordre pour tous les États concernés, car on n’est jamais à l’abri d’une 3e tragédie qui pourrait à nouveau faire plonger le secteur. Ou de l’émergence d’une alternative à l’uranium. Le thorium, par exemple...
Emiliano Tossou